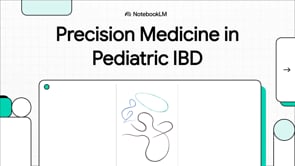La médecine de précision transforme la prise en charge des enfants atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) en s’appuyant sur les données individuelles des patients pour choisir le traitement adéquat, à la dose et au moment les plus adaptés. Cette approche intégrative associe des biomarqueurs génétiques, microbiens et protéiques afin de prédire la sévérité de la maladie et la réponse aux traitements, dans le but de dépasser le plafond thérapeutique actuel, où seuls 20 à 50 % des patients parviennent à la rémission. En permettant des interventions plus précoces et ciblées, voire en ouvrant la voie à des stratégies préventives, la médecine de précision représente un espoir majeur pour réduire les complications, les actes chirurgicaux et les handicaps à long terme chez les jeunes patients atteints de MICI.
Guide du patient sur la médecine de précision dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin pédiatriques
Table des matières
- Introduction : Pourquoi la médecine de précision est importante dans les MICI pédiatriques
- Bon patient : Identifier les patients nécessitant un traitement agressif
- Prédicteurs cliniques et biologiques
- Marqueurs sérologiques
- Facteurs de risque génétiques
- Biomarqueurs protéiques
- Profils d'expression génique
- Facteurs liés au microbiote intestinal
- Outils d'aide à la décision clinique
- Bon traitement : Adapter les thérapeutiques aux profils patients
- Traitements anti-TNF
- Traitements anti-intégrine
- Traitements anti-IL-12/IL-23
- Pharmacogénomique : Génétique et sécurité médicamenteuse
- Bonne posologie : Optimiser les taux médicamenteux
- Suivi thérapeutique pharmacologique
- Conclusion : L'avenir de la prise en charge personnalisée des MICI
- Sources d'information
Introduction : Pourquoi la médecine de précision est importante dans les MICI pédiatriques
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), qui incluent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, sont en augmentation dans le monde depuis la révolution industrielle. Environ 25 % des cas sont diagnostiqués avant l'âge de 20 ans, ce qui en fait souvent une maladie pédiatrique. Bien que l'incidence se soit stabilisée en Amérique du Nord et en Europe occidentale, le nombre total de personnes atteintes continue de croître en raison du vieillissement des patients et de l'augmentation des nouveaux cas dans les pays nouvellement industrialisés.
Le fardeau mondial des MICI s'alourdit considérablement, créant des pressions pour les patients et les systèmes de santé en raison de la morbidité importante et des coûts élevés des traitements. La médecine de précision offre une approche essentielle pour améliorer l'efficacité des soins pour cette population croissante et pourrait même permettre d'identifier des stratégies de prévention.
On estime généralement qu'il existe un « plafond thérapeutique » dans les MICI : tous les traitements, anciens comme nouveaux, n'entraînent une rémission que chez 20 à 50 % des patients, et de nombreux répondeurs initiaux finissent par perdre leur réponse au fil du temps. À chaque échec thérapeutique, les patients subissent une inflammation persistante et une accumulation de lésions intestinales, pouvant conduire à l'hospitalisation, à la chirurgie, à des complications, à la fibrose, à une incapacité fonctionnelle, voire au cancer colorectal.
Bon patient : Identifier les patients nécessitant un traitement agressif
Les MICI pédiatriques sont extrêmement diverses, avec des sous-types variés et des manifestations extra-intestinales complexes. Comme il est idéal d'instaurer précocement un traitement efficace, distinguer les patients à faible risque de ceux à haut risque de progression et de complications devient crucial pour orienter le choix thérapeutique initial.
Actuellement, les cliniciens évaluent de manière assez rudimentaire les caractéristiques cliniques et biologiques pour déterminer le risque de progression. À l'avenir, les vastes bases de données génomiques, protéomiques, microbiennes et métabolomiques continueront de s'enrichir et seront intégrées dans des modèles prédictifs. Aidés par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, les cliniciens pourront utiliser ces modèles plus précis pour mieux identifier les patients à haut risque nécessitant une intervention agressive précoce, tout en épargnant aux patients à faible risque des traitements agressifs inutiles.
Prédicteurs cliniques et biologiques
Certaines caractéristiques cliniques et résultats biologiques de routine ont été associés à une maladie compliquée et/ou à la chirurgie dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique :
Prédicteurs de la maladie de Crohn pédiatrique :
- Maladie sténosante au diagnostic
- Indice d'activité pédiatrique de la maladie de Crohn (PCDAI) > 10 à la 12e semaine de traitement
- Durée d'évolution plus longue et âge plus jeune au diagnostic (associés à 46 % de récidive endoscopique à 2 ans après chirurgie malgré les biothérapies)
- Localisation iléale de la maladie et âge plus avancé au diagnostic
- Protéine C-réactive (CRP) ≥ 5 mg/dL (associée à une maladie modérée à sévère)
Prédicteurs de la rectocolite hémorragique pédiatrique :
- Pancolite (inflammation de l'ensemble du côlon)
- Colite sévère (PUCAI > 65) au diagnostic
- Hypoalbuminémie (faible taux d'albumine) au diagnostic
- Score PUCAI > 10 après 3 mois de traitement
Marqueurs sérologiques
Les réponses anticorps aux micro-organismes intestinaux ont été utilisées pour prédire le risque. Le taux de maladie de Crohn compliquée et évolutive augmente avec l'intensité de la réactivité immunitaire. Les patients positifs pour deux marqueurs sérologiques ou plus (ASCA, OmpC, et/ou CBir1) ont progressé plus rapidement vers une maladie compliquée que ceux avec un seul marqueur.
Dans la rectocolite hémorragique, un titre élevé de pANCA (>100 UE/mL) a été associé à la pancolite et à la pochite chronique après chirurgie.
Facteurs de risque génétiques
De vastes études génétiques ont identifié des loci de risque dans l'ADN associés à une évolution compliquée. L'allèle de risque le plus fort identifié est NOD2, initialement associé à la maladie de Crohn compliquée, définie par le développement de sténoses et la nécessité d'une chirurgie.
D'autres loci de risque (FOXO3, XACT, IGFBP1, et la région MHC entre HLA-B et HLA-DR) ont été identifiés comme associés à un mauvais pronostic, mais nécessitent une validation supplémentaire. Dans la rectocolite hémorragique, l'allèle HLA DRB1*0103 est associé à la pancolite et à la nécessité d'une colectomie.
Un score de risque polygénique à l'échelle du génome, intégrant les effets additifs des variants génétiques, peut estimer le risque de certains phénotypes en fonction du génotype. Pour les MICI, ce score a montré une aire sous la courbe (AUC) de 0,63 dans les ensembles de test et de validation, signifiant qu'il classait correctement les patients dans 63 % des cas.
Biomarqueurs protéiques
Un objectif majeur de la médecine de précision dans les MICI est d'identifier des biomarqueurs surpassant la calprotectine fécale dans la détection des lésions endoscopiques, sans les problèmes d'insatisfaction ou d'observance des patients.
Dans l'étude de cohorte RISK, utilisant un panel de marqueurs protéiques sanguins, cinq protéines étaient associées aux complications pénétrantes (AUC 0,79, IC 95 % : 0,76-0,82) et quatre aux complications sténosantes (AUC 0,68, IC 95 % : 0,65-0,71). Les taux de chaîne alpha 1 du collagène de type III (COL3A1) au diagnostic étaient plus élevés chez les patients ayant développé des sténoses.
Un panel de 13 marqueurs protéiques (appelé indice sérique de cicatrisation endoscopique) a été validé dans la maladie de Crohn pour distinguer l'activité endoscopique, avec une performance comparable à la calprotectine fécale et supérieure à la CRP.
Profils d'expression génique
Des profils d'expression génique spécifiques ont été liés au pronostic et au type de MICI. Dans la maladie de Crohn, une expression iléale élevée de gènes de la matrice extracellulaire était associée au développement ultérieur de sténoses. Un score de risque transcriptionnel dérivé de l'expression génique associée à des allèles de risque connus de MICI semble prometteur pour identifier les patients Crohn susceptibles de développer des complications au fil du temps.
Une signature transcriptionnelle disponible commercialement dans les lymphocytes T CD8 périphériques, associée à l'épuisement des lymphocytes T, a montré des résultats initiaux prometteurs comme prédicteur potentiel de maladie plus agressive et est actuellement en cours de validation.
Dans la rectocolite hémorragique, un profil d'expression génique de type 2 était associé à une probabilité plus élevée d'atteindre la rémission clinique. Un taux plus élevé d'éosinophiles était associé à une moindre probabilité de nécessiter une escalade du 5-ASA vers un anti-TNF.
Facteurs liés au microbiote intestinal
Un déséquilibre de la composition microbienne par rapport aux témoins sains, appelé dysbiose, est fréquent dans les MICI. Cette dysbiose se caractérise par une diminution de la diversité et de l'abondance bactériennes, avec des preuves croissantes du rôle des champignons et des virus.
Dans une cohorte pédiatrique de MICI, une dysbiose microbienne sévère était associée à des phénotypes de maladie étendue et/ou compliquée, à l'utilisation de biothérapies, et à l'échec d'atteindre la cicatrisation muqueuse. Les classificateurs décrivant la structure du microbiote et l'activité métabolique sont associés au statut MICI.
Outils d'aide à la décision clinique
Toutes ces caractéristiques sont de plus en plus intégrées dans des outils complets d'aide à la décision clinique pouvant être incorporés directement aux dossiers médicaux électroniques. Actuellement, un outil commercial est disponible pour la maladie de Crohn (CD-PATH), classant les patients en groupes à faible, moyen et haut risque sur la base de marqueurs cliniques, sérologiques et génétiques, avec une précision prédictive de 75 % chez les enfants.
Pour le vedolizumab, un outil d'aide à la décision utilisant des données cliniques et biologiques a identifié les patients susceptibles d'atteindre la rémission sans corticostéroïdes et a différencié ceux nécessitant un raccourcissement de l'intervalle.
Bon traitement : Adapter les thérapeutiques aux profils patients
La sélection thérapeutique repose actuellement sur des facteurs cliniques tels que le risque de progression, la localisation, la sévérité et l'activité de la maladie. La première biothérapie, quel que soit le choix, a la probabilité de succès la plus élevée.
La séquence des traitements affecte également l'efficacité. Dans la rectocolite hémorragique, le vedolizumab est moins efficace s'il est administré après un anti-TNF, tandis que cet effet négatif est moins marqué avec l'ustékinumab. À chaque échec thérapeutique, les patients subissent des symptômes en attendant la réponse, conduisant à l'incapacité, à l'exposition aux corticostéroïdes et à une utilisation accrue des soins de santé.
Traitements anti-TNF
Plusieurs profils d'expression génique de base ont été identifiés chez les patients MICI traités par anti-TNF, associés à une non-réponse ultérieure. Une expression plus élevée d'Oncostatine M (OSM) était associée à la non-réponse aux anti-TNF (risque relatif = 5, IC 95 % : 1,4-17,9) avec une AUC impressionnante de 0,99.
Une faible expression du récepteur déclencheur exprimé sur les cellules myéloïdes 1 (TREM-1) a également été associée à la non-réponse aux anti-TNF dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Un module cellulaire comprenant des plasmocytes IgG, des phagocytes mononucléés inflammatoires, des lymphocytes T activés et des cellules stromales était associé à l'échec d'atteindre la rémission clinique sans corticostéroïdes sous anti-TNF.
Traitements anti-intégrine
Dans une cohorte rétrospective de 251 patients MICI, l'éosinophilie muqueuse colique pré-thérapeutique prédisait la non-réponse au vedolizumab à 6 mois. L'α4β7 circulant pourrait également être un marqueur de réponse au vedolizumab.
Un algorithme de réseau neuronal pour prédire la rémission clinique à la 14e semaine sous vedolizumab avait une puissance prédictive améliorée lorsque les données microbiennes étaient combinées aux données cliniques (données cliniques seules : AUC = 0,619 ; données cliniques et microbiennes : AUC = 0,872). Une diversité microbienne accrue au diagnostic était associée à la réponse au vedolizumab.
Traitements anti-IL-12/IL-23
Dans un essai clinique du brazikumab (un anti-IL-23) pour la maladie de Crohn, les concentrations d'interleukine-22 (IL-22) mesurées au diagnostic ont montré que des niveaux supérieurs à 15,6 pg/mL étaient associés à une probabilité accrue de rémission clinique à la 8e semaine.
Il existe un taux accru de psoriasis dans les MICI comparé à la population générale, et une incidence plus élevée d'antécédents familiaux de psoriasis dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Les variants du gène IL23R confèrent une protection dans le psoriasis et les MICI, et les traitements ciblant cette voie se sont avérés efficaces dans les deux affections.
Pharmacogénomique : Génétique et sécurité médicamenteuse
Les thiopurines (6-mercaptopurine et azathioprine) font partie des premiers médicaments utilisés dans les MICI mais peuvent entraîner des effets indésirables graves, notamment une leucopénie et une pancréatite. Ces médicaments sont métabolisés par l'enzyme thiopurine méthyltransférase (TPMT).
La stratégie de médecine de précision la plus ancienne dans les MICI consiste probablement à utiliser le génotypage de la TPMT ou son taux enzymatique pour déterminer la posologie des thiopurines. Dans une vaste étude néerlandaise, les porteurs de variants de la TPMT avec réduction de dose ont présenté une réduction de 10 fois des événements leucopéniques (RR : 0,11 ; IC 95 % : 0,01-0,85).
Un variant génétique de NUDT15 a également été identifié comme associé à un risque accru de leucopénie sous thiopurines, et il peut être additif avec les variants de la TPMT. Actuellement, il est recommandé de vérifier à la fois la TPMT et NUDT15 avant d'initier un traitement par thiopurines pour guider la posologie ou potentiellement éviter leur utilisation chez un petit sous-groupe à haut risque.
Le groupe d'allèles HLA-DQA1*05 est associé au délai d'apparition des anticorps anti-médicament dirigés contre les anti-TNF (rapport de risque : 1,90 ; IC 95 % : 1,60-2,25). Ce test est désormais disponible commercialement pour un usage clinique.
D'autres variants génétiques associés à des issues défavorables incluent un polymorphisme dans la région de classe II du HLA (rs2647087) associé à un risque accru de pancréatite sous thiopurines—les patients homozygotes pour ce gène présentent un risque de 17 % de développer une pancréatite.
Bonne posologie : Optimiser les taux médicamenteux
Les traitements des MICI ayant une efficacité limitée, ils doivent être sélectionnés et optimisés de manière rationnelle pour maximiser l'effet thérapeutique et vérifier que les paramètres pharmacocinétiques ne limitent pas l'efficacité. Cette optimisation implique des ajustements de dose et d'intervalle ou l'ajout d'une médication combinée, souvent basée sur le suivi thérapeutique pharmacologique.
Suivi thérapeutique pharmacologique
Le suivi thérapeutique pharmacologique est utilisé pour optimiser à la fois les thiopurines et les biothérapies. Pour les thiopurines, le dosage des métabolites est une pratique depuis longtemps acceptée. Lorsqu'elles sont utilisées seules, les concentrations des métabolites des thiopurines peuvent être mesurées pour s'assurer d'une posologie appropriée.
Conclusion : L'avenir de la prise en charge personnalisée des MICI
La médecine de précision dans les MICI pédiatriques représente une approche transformationnelle des soins qui va au-delà des stratégies thérapeutiques standardisées. En intégrant plusieurs types de données patient—incluant les informations génétiques, protéomiques, microbiennes et cliniques—les cliniciens peuvent mieux prédire l'évolution de la maladie, sélectionner les traitements optimaux, déterminer les posologies appropriées et planifier correctement les interventions.
Le développement d'outils d'aide à la décision clinique intégrés aux dossiers médicaux électroniques rendra ces prédictions complexes plus accessibles aux cliniciens. Alors que la recherche continue de valider des biomarqueurs supplémentaires et d'affiner les algorithmes existants, la médecine de précision promet non seulement de franchir le plafond thérapeutique actuel mais aussi potentiellement d'atteindre des objectifs jusque-là inaccessibles comme la prévention de la maladie chez les individus à risque.
Pour les patients et les familles confrontés aux MICI pédiatriques, ces avancées offrent l'espoir de traitements plus efficaces et personnalisés qui minimisent les approches par essais-erreurs, réduisent le risque de complications, d'hospitalisations et de chirurgies, tout en améliorant la qualité de vie à long terme.
Sources d'information
Titre de l'Article Original : Médecine de Précision dans la Maladie Inflammatoire Chronique de l'Intestin Pédiatrique
Auteurs : Elizabeth A. Spencer, MD, Marla C. Dubinsky, MD
Publication : Pediatric Clinics of North America, Volume 68, Numéro 6, Décembre 2021, Pages 1171-1190
Note : Cet article adapté aux patients est basé sur une recherche évaluée par des pairs et vise à traduire des informations scientifiques complexes en un contenu accessible pour les patients et aidants informés.