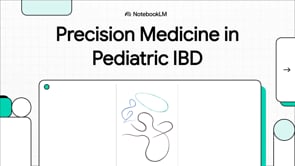Le Canada affiche l'un des taux les plus élevés au monde de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) pédiatriques, avec environ 6 158 enfants actuellement touchés et 600 à 650 nouveaux cas diagnostiqués chaque année chez les moins de 16 ans. Cette revue complète explore les avancées récentes dans la prise en charge des MICI pédiatriques, notamment l'augmentation de l'incidence, les découvertes génétiques, les thérapies nutritionnelles comme la nutrition entérale exclusive, ainsi que les nouveaux traitements biologiques qui révolutionnent la prise en charge de cette pathologie complexe chez les jeunes patients.
Progrès récents dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en pédiatrie
Sommaire
- Introduction : L’enjeu croissant des MICI pédiatriques
- Avancées génétiques dans les MICI de l’enfant
- Régime alimentaire et thérapies nutritionnelles
- Traitements médicamenteux
- Nouvelles options thérapeutiques
- Objectifs thérapeutiques chez l’enfant atteint de MICI
- Sources
Introduction : L’enjeu croissant des MICI pédiatriques
Le Canada est confronté à un défi majeur avec les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) chez l’enfant, qui incluent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Les données récentes indiquent que notre pays présente l’un des taux les plus élevés de MICI à début pédiatrique au monde. Actuellement, environ 6 158 enfants et jeunes de moins de 18 ans vivent avec une MICI, et les médecins diagnostiquent chaque année 600 à 650 nouveaux cas chez les moins de 16 ans.
Ce nombre devrait atteindre 8 079 enfants d’ici 2035, ce qui est préoccupant. Ces nouveaux cas pédiatriques représentent environ 10 à 20 % de l’ensemble des nouveaux diagnostics de MICI. L’augmentation la plus marquée concerne les enfants de moins de 5 ans, bien que les MICI débutant à l’adolescence restent plus fréquentes.
Les données sanitaires récentes montrent qu’en 2023, l’incidence nationale globale des MICI était de 29,9 pour 100 000 personnes (intervalle de confiance à 95 % : 28,3–31,5). L’incidence augmente en pédiatrie (variation annuelle moyenne en pourcentage : 1,27 % ; IC95% : 0,82–1,67), alors qu’elle reste stable chez les adultes (VAMP : 0,26 % ; IC95% : -0,42–0,82). Cette hausse pédiatrique est un phénomène mondial activement étudié.
La prise en charge des MICI en pédiatrie évolue vers une médecine de précision, avec des approches standardisées intégrant la génétique, la stratification du risque, la caractérisation phénotypique, les thérapies nutritionnelles et avancées, ainsi que des cliniques multidisciplinaires spécialisées, attentives aux défis spécifiques des jeunes patients et de leurs familles.
Avancées génétiques dans les MICI de l’enfant
La recherche a établi que les facteurs génétiques, la dysbiose microbienne (déséquilibre du microbiote intestinal) et les réponses immunitaires anormales, combinés à des facteurs environnementaux, sont les principaux éléments influençant le développement des MICI. Leur importance varie probablement selon l’âge au diagnostic.
Grâce aux progrès du séquençage ADN de nouvelle génération, il est désormais possible d’établir un diagnostic génétique chez les enfants atteints de MICI ou de pathologies similaires, qualifiées de « MICI monogéniques ». Ces cas, généralement rares, se caractérisent par une forme sévère et une résistance aux traitements conventionnels. Une revue systématique récente a recensé les cas confirmés de MICI monogénique, identifiant comme anomalies les plus fréquentes la colite par déficit de signalisation de l’interleukine-10 (IL-10), suivie de la maladie granulomateuse chronique (MGC) et du déficit en inhibiteur de l’apoptose lié à l’X (XIAP).
Il est notable que plus de 10 % des cas de MICI monogénique ont été identifiés chez des adultes, montrant que ces formes peuvent se manifester plus tardivement. La recherche a révélé que 76 % des patients atteints de MICI monogénique ont développé au moins une manifestation extra-intestinale, avec des traitements incluant la chirurgie (27,1 %), la transplantation de cellules souches hématopoïétiques (23,1 %) et les biologiques (32,9 %).
Ces données soulignent la diversité des maladies monogéniques. Un test génétique devrait être envisagé pour tout patient présentant une manifestation atypique, une atteinte extra-intestinale significative ou une résistance aux traitements standards.
Régime alimentaire et thérapies nutritionnelles
L’alimentation est impliquée à la fois dans le développement et l’évolution des MICI, comme en attestent de nombreuses études. Les recherches épidémiologiques montrent des associations négatives avec les régimes de type occidental et des effets protecteurs du régime méditerranéen. Les modèles animaux suggèrent un rôle des aliments ultra-transformés dans l’inflammation.
En pédiatrie, la nutrition entérale exclusive (NEE) reste la base du traitement nutritionnel de la maladie de Crohn – les patients reçoivent exclusivement une formule liquide pendant plusieurs semaines. Au Canada, son utilisation pour l’induction de la rémission est comparable à celle des corticostéroïdes, selon les données du Réseau canadien des MICI de l’enfant.
La NEE a prouvé son efficacité pour induire la rémission, favoriser la cicatrisation muqueuse et améliorer l’état nutritionnel. Elle est également bénéfique chez les enfants présentant une maladie sténosante/pénétrante ou des masses inflammatoires. La sélection des patients et un accompagnement diététique dans un centre spécialisé sont essentiels à son succès.
Les patients avec une atteinte iléale distale et une sévérité légère à modérée répondent mieux à la NEE. Des études sur les signatures microbiome et les marqueurs génétiques prédictifs de la réponse sont en cours.
De nombreux régimes dits « thérapeutiques » ont été proposés pour les MICI – une revue récente en recense plus de 24. Le plus étudié est le Crohn’s Disease Exclusion Diet (CDED), qui associe restrictions alimentaires et nutrition entérale partielle (NEP) en phases successives.
Les restrictions sont fondées sur des données animales montrant l’impact de certains aliments sur l’inflammation, la dysbiose ou la perméabilité intestinale. Cette approche a donné des résultats comparables à la NEE pour l’induction de rémission à 6 semaines (75 % avec CDED + NEP contre 59 % avec NEE), mais son efficacité est limitée dans les formes sévères ou en cas d’échec aux biologiques.
Dans les centres pédiatriques canadiens, les recommandations nutritionnelles varient encore considérablement, en l’absence de données robustes sur les régimes thérapeutiques – une source de frustration pour les familles cherchant des solutions diététiques.
Traitements médicamenteux
Le nombre de traitements médicamenteux approuvés pour les MICI chez l’adulte a considérablement augmenté récemment. Leur indisponibilité pour les enfants pose un problème croissant en pratique pédiatrique. Le délai avant la réalisation d’essais contrôlés et l’obtention des autorisations conduit à une utilisation prolongée hors AMM des nouvelles thérapies.
Les traitements d’induction traditionnels (corticostéroïdes, NEE) restent utilisés, mais l’emploi des immunomodulateurs en monothérapie d’entretien, surtout dans la maladie de Crohn, a diminué au profit d’approches « treat-to-target » précoces. Cela est crucial car la majorité des jeunes patients présentent une maladie modérée à sévère et étendue.
Dans la rectocolite hémorragique, l’étude PROTECT a montré qu’une proportion significative d’enfants répondant aux stéroïdes bénéficient des 5-ASA, mais à 52 semaines, seulement 40 % ont pu maintenir ce traitement sans escalade thérapeutique.
Les anti-TNF (infliximab, adalimumab) restent les traitements d’entretien les plus utilisés en pédiatrie, en raison de leur ancienneté et de leur efficacité. Cependant, environ un tiers des patients n’y répondent pas, et 20 à 30 % supplémentaires perdent secondairement la réponse, avec ou sans développement d’anticorps.
Le dosage basé sur la surface corporelle chez les jeunes enfants et la surveillance proactive des taux sériques semblent bénéfiques, probablement en raison de différences de clairance et de composition corporelle. Les enfants plus jeunes et plus légers nécessitent des doses plus élevées par kilogramme pour atteindre une exposition comparable.
Nouvelles options thérapeutiques
En 2014, le vedolizumab est devenu le premier anti-intégrine ciblant spécifiquement α4β7 dans les maladies gastro-intestinales de l’adulte. Utilisé hors AMM en pédiatrie, d’abord chez les patients résistants aux anti-TNF, il l’est désormais aussi en première intention, surtout dans la rectocolite hémorragique.
Plusieurs études observationnelles pédiatriques confirment son innocuité et son efficacité. La plus large, VEDOKIDS, a montré des taux de rémission sans stéroïdes de 42 % à 14 semaines dans la rectocolite hémorragique et 32 % dans la maladie de Crohn. Un certain bénéfice est observé chez les patients naïfs de traitement. Son excellent profil de sécurité en fait une option attractive.
L’ustékinumab, anticorps monoclonal ciblant la sous-unité p40 de l’IL-12/IL-23, est approuvé chez l’adulte et utilisé hors AMM chez l’enfant au Canada depuis 2016. Les données canadiennes indiquent 44 % de rémission sans stéroïdes à 52 semaines dans la rectocolite hémorragique après échec anti-TNF, et 38,6 % dans la maladie de Crohn. Son innocuité est bonne.
Les inhibiteurs de JAK-STAT, premières petites molécules ciblées utilisées dans les MICI, montrent une efficacité et une sécurité préliminaires encourageantes chez l’enfant, avec jusqu’à 41,2 % de rémission sans stéroïdes à 52 semaines. Une petite étude note une réduction des colectomies chez les patients hospitalisés résistants aux stéroïdes et anti-TNF.
De nouvelles molécules ciblant p19 (spécifique de l’IL-23), comme le risankizumab, le mirikizumab et le guselkumab, sont en essais chez l’adulte avec des résultats prometteurs. Les essais pédiatriques sont en cours. Les modulateurs des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate (S1P), comme l’ozanimod, constituent une autre classe émergente, actuellement étudiée dans la maladie de Crohn pédiatrique.
Avec ces nouvelles options, les spécialistes disposeront de plus de traitements pour leurs patients. Les données sur le séquençage et le positionnement thérapeutique deviendront cruciales. La recherche explore aussi les thérapies « multimodales » associant plusieurs biologiques ou biologiques et petites molécules pour les cas réfractaires, élargissant l’arsenal thérapeutique.
Objectifs thérapeutiques chez l’enfant atteint de MICI
Les objectifs initiaux des soins en pédiatrie sont similaires à ceux de l’adulte : obtenir une rémission clinique prolongée sans stéroïdes et une cicatrisation muqueuse pour prévenir les complications à long terme. Mais les enfants ont des besoins supplémentaires spécifiques, nécessitant une attention particulière.
Ces priorités incluent l’optimisation de la croissance staturo-pondérale, pubertaire et psychologique, le maintien d’une nutrition et d’une qualité de vie satisfaisantes pendant la scolarité et l’adolescence, et une vigilance accrue face aux toxicités potentielles des traitements, compte tenu de la durée prolongée de exposition.
Compte tenu de ces enjeux complexes, il est de plus en plus admis que les enfants atteints de MICI devraient être pris en charge dans des centres spécialisés multidisciplinaires, avec accès à des médecins, infirmières, diététiciens et professionnels de santé mentale experts. Cette approche collective garantit des soins de haute qualité tout au long de l’enfance et de l’adolescence.
Sources
Titre de l’article original : Actualités dans la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques intestinales de l’enfant
Auteur : Nicholas Carman, MBBS, FRACP
Affiliations de l’auteur : Centre des maladies inflammatoires chroniques intestinales de SickKids, Division de gastroentérologie, hépatologie et nutrition, The Hospital for Sick Children (SickKids), Toronto, Ontario ; Université de Toronto
Publication : Volume 2, Numéro 1, Printemps 2024
Cet article destiné aux patients s’appuie sur une recherche évaluée par des pairs et conserve toutes les conclusions significatives, statistiques et informations cliniques de la publication scientifique originale.